A propos de "La longueur de la chaîne"
Une interview dans l'Humanité Dimanche du 21 avril 2011
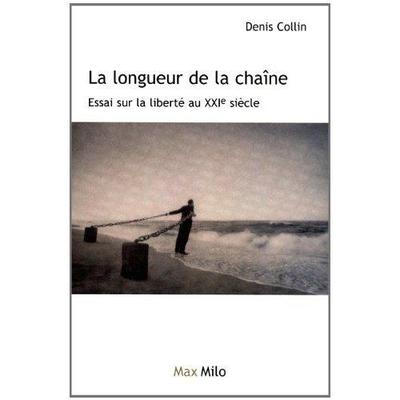 Cette question nous renvoie aux ambiguïtés du mot « démocratie ». Incontestablement nos gouvernants actuels ont été élus démocratiquement et l’on peut penser que, si le sort des urnes leur est défavorable, ils accepteront le verdict populaire. Pourtant quand un futur président fait campagne sur le thème de la défense de ceux qui se lèvent tôt (les ouvriers) pour fêter immédiatement son succès dans un des lieux symboles de ceux qui se couchent tard (le Fouquet’s), il y a là un incontestable pied-de-nez à la démocratie et à l’esprit républicain : l’actuel président a voulu signifier que les promesses électorales n’engagent que ceux qui y croient ! Comme à la fin de la république romaine ou en d’autres périodes plus récentes, la démocratie plébiscitaire se révèle le pire ennemi de la démocratie. Sous couvert de démocratie formelle, c’est le règne de l’oligarchie et si on respecte « l’alternance », tout est fait pour que l’éventuelle opposition soit choisie au sein de l’oligarchie…
Cette question nous renvoie aux ambiguïtés du mot « démocratie ». Incontestablement nos gouvernants actuels ont été élus démocratiquement et l’on peut penser que, si le sort des urnes leur est défavorable, ils accepteront le verdict populaire. Pourtant quand un futur président fait campagne sur le thème de la défense de ceux qui se lèvent tôt (les ouvriers) pour fêter immédiatement son succès dans un des lieux symboles de ceux qui se couchent tard (le Fouquet’s), il y a là un incontestable pied-de-nez à la démocratie et à l’esprit républicain : l’actuel président a voulu signifier que les promesses électorales n’engagent que ceux qui y croient ! Comme à la fin de la république romaine ou en d’autres périodes plus récentes, la démocratie plébiscitaire se révèle le pire ennemi de la démocratie. Sous couvert de démocratie formelle, c’est le règne de l’oligarchie et si on respecte « l’alternance », tout est fait pour que l’éventuelle opposition soit choisie au sein de l’oligarchie…
2/ Au-delà des hommes et femmes politiques actuellement au pouvoir, peut-on dire que face aux « besoins du capital » mondialisé la République française a dû renoncer à la démocratie ? Que nous sommes passés à un régime post-démocratique ?
Il ne s’agit pas d’un phénomène spécifiquement français. Les vieilles démocraties, reposant sur des partis de masse qui exprimaient, plus ou moins, les aspirations des électeurs, sont à l’agonie. Les partis dominants sont désormais conçus comme des entreprises au service d’un chef. Mauro Calise, un politologue italien, analyse bien la montée de ce qu’il appelle « le parti personnel », dont le New Labour de Tony Blair a été une première version, quasi contemporaine de la montée du parti de Berlusconi en Italie. La prise de pouvoir de Nicolas Sarkozy dans l’UMP, prélude à sa campagne présidentielle victorieuse, s’inscrit dans ce schéma. Vu de l’extérieur, on pourrait aussi penser à une étrange convergence entre les « démocraties occidentales » et le système russe sous Poutine. Mais les bases sociales et le rapport à l’État sont un peu différents. La « classe capitaliste transnationale » (pour parler comme Leslie Sklair) garde le décorum démocratique, mais l’a complètement vidé de l’intérieur. Les élus et les parlements sont transformés en simples relais de décisions largement prises ailleurs. Il suffit de voir comment fonctionne la machine « Union Européenne ».
3/ « Ce qui se joue dans la « superstructure politique » dépend dans une large mesure de ce qui se passe dans la « salle des machines », c’est-à-dire là où se produisent les conditions matérielles de l’existence humaine ». Quels rapports établissez-vous entre le fonctionnement des entreprises aujourd’hui et l’involution de la démocratie ?
La salle des machines, c’est la production et donc la division internationale du travail – et pas seulement les rapports à l’intérieur de l’entreprise. Le fonctionnement des entreprises est asservi aux nouveaux modes d’accumulation du capital. Même si la brutalité des relations sociales peut faire penser à un retour au capitaliste du XIXe siècle, nous avons affaire à autre chose. Citons trois traits : d’abord, dans certaines grandes entreprises, ce qu’on a appelé le « management par la terreur » qui s’est retrouvé sous les feux de l’actualité, mais qui peut aussi prendre des formes plus douces d’une volonté de contrôle des pensées et de mise en conformité idéologique des employés ; ensuite l’externalisation croissante, non seulement de certaines parties de la production (la sous-traitance, c’est très ancien), mais aussi des fonctions de direction avec le développement des cabinets d’audit, des coaches, des intervenants en tous genre, ce qui va de pair avec l’intégration croissante des classes moyennes supérieures aux objectifs et aux façons de penser du capital financier ; et enfin, l’intrication croissante des entreprises privées et des institutions publiques avec une véritable privatisation de tout l’espace politique. La pression sur les salariés vise, non sans certains succès, à les dissuader de s’engager dans l’action collective. Alors que pendant longtemps, on avait vu dans les ITC (ingénieurs, cadres et techniciens) des partenaires « naturels » d’un « front de classe » pour la transformation sociale, il faut reconnaître que les transformations des classes moyennes supérieures y ont produit du consentement à l’inégalité. Enfin, la privatisation de l’espace public et la propension à gérer les collectivités locales comme des entreprises sont évidemment des armes de destruction massive de la démocratie. La réforme des collectivités locales (avec la suppression de fait des départements, l’amenuisement du rôle des communes remplacées par des usines à gaz genre « grand Paris ») découle entièrement de cette logique entrepreneuriale. On détruit par là tous ces germes d’autogouvernement qui constituent à la fois l’âme de la république et les embryons d’un nouveau régime social.
4/ La généralisation du salariat ne peut pas conduire au « dépassement du capitalisme », affirmez-vous. Pourquoi ?
Le salariat, tel que Marx le définit, n’est rien d’autre que le système dans lequel les ouvriers se font mutuellement concurrence pour vendre leur force de travail. Que le patron soit un patron privé ou l’État ne change rien (sinon qu’on peut encore espérer faire jouer la concurrence entre les patrons alors que le monopole d’État ligote le travailleur soumis pieds et poings liés à la bureaucratie, comme nous l’a appris l’expérience du siècle passé !). Aujourd’hui, les grandes fortunes privées représentent une part très minoritaire de la capitalisation boursière. L’essentiel du capital est détenu par des institutions (fonds de pension, fonds de placement, fonds souverains, etc.) qui centralisent le capital formellement possédé par les individus appartenant aux classes moyennes ou même à la classe ouvrière. Au début du mouvement ouvrier, le mot d’ordre était abolition du salariat et du patronat. C’est ce qu’on trouve dans la charte d’Amiens adoptée par la CGT en 1906. La lutte syndicale quotidienne devait se mener dans la perspective d’une émancipation de la classe ouvrière, ce qui suppose la disparition de ce lien de subordination et de domination qu’est toujours le rapport salarial. Progressivement, on a oublié le but, pour se concentrer sur l’amélioration du sort des ouvriers au sein du mode de production capitaliste, pour augmenter la longueur de la chaîne, mais en perdant progressivement de vue la suppression des chaînes du salariat. Évidemment, la lutte réformiste n’est nullement méprisable. Elle a même conduit à la création d’institution « proto-communistes » pourrait-on dire, au sein même de la société capitaliste. Je pense à la Sécurité sociale qui, en théorie du moins, fonctionne sur le principe communiste, « de chacun ses capacités, à chacun selon ses besoins ». Mais on voit bien aujourd’hui que le développement du capitalisme est incompatible avec l’existence de ces institutions ouvrières. Destructions des services publics, privatisation du système mutualiste dont la Sécu était l’exemple le plus achevé, et cela ne vient pas de la spéciale méchanceté des capitalistes, mais bien de la logique même de l’accumulation du capital : le capital est un automate qui impose ses propres lois y compris à ces « fonctionnaires du capital » que sont les capitalistes. Ce qui est à l’ordre du jour, ce n’est pas l’impossible retour aux « trente glorieuses », mais la construction d’une alternative radicale permettant la sortie du salariat et la marche vers « les producteurs associés » pour parler encore comme Marx. Pour cela, nous avons besoin d’une réflexion théorique (comme celle que mène Tony Andréani sur « les modèles de socialisme ») d’expérimentation pratique. Un gouvernement au service de la majorité du peuple devrait se donner pour objectif d’avancer dans cette voie, même si c’est une voie « réformiste », c’est-à-dire même si on admet qu’il faut une fois pour toutes en finir avec les illusions de la « table rase ».
5/ Vous dites que « la critique ne vaut que si elle ouvre une voie nouvelle ». Que faire concrètement pour travailler à la rupture des chaînes économico-politiques qui nous entravent ?
Les questions économiques et politiques sont en effet étroitement liées. Il y a un mot qui unit toutes ces questions, la liberté, ou plus exactement la liberté à gagner, c’est-à-dire l’émancipation. De ce point de vue, il n’est pas possible de construire une véritable alternative sans assumer l’héritage du libéralisme politique et du républicanisme. Car si la république est le principe de non-domination, ce principe concerne à la fois la limitation du pouvoir politique (séparation des pouvoirs, protection des droits individuels, droit de contestation garantie, etc.) et la protection contre la domination dans l’ensemble de la sphère socio-économique (contre la domination dans le travail ou la domination patriarcale). L’égalité, dans ce contexte, n’est pas la fin, mais le moyen de garantir la non-domination. Que personne ne soit assez riche pour acheter un autre homme et que personne ne soit assez pauvre pour être dans la contrainte de se vendre (comme dit Rousseau), cela ne fait pas une société égalitaire, mais une société dans laquelle les inégalités de fortune ne peuvent devenir des moyens de domination des plus riches sur les plus pauvres. Cela suppose la répartition la plus large de la propriété – l’accès de chacun à la propriété individuelle – en même temps que la disparition (peut-être très progressive) de la propriété proprement capitaliste. On pourrait baptiser cette orientation « communisme républicain », un communisme qui reposerait largement sur le principe de la coopération ou de l’association, bref un communisme qui abandonne les impasses collectivistes pour revenir à Marx. Il y aurait aussi sans doute pas mal de choses à rechercher dans la véritable tradition du « socialisme libéral » au sens italien, celui de Carlo Rosselli et du « parti d’action » dans la résistance à Mussolini.
Au-delà du travail théorique, il s’agit de promouvoir toutes les formes d’auto-organisation sociale, depuis la simple association culturelle jusqu’aux diverses formes de coopératives. La crise du capitalisme ne peut que contraindre les individus à agir par eux-mêmes – on le voit bien en Italie aujourd’hui, où la crise politique et le délabrement économique se combinent avec une grande vitalité de la société civile, depuis les associations qui organisent la solidarité face à la disparition des services publics jusqu’aux mouvements qui organisent des manifestations impressionnantes contre Berlusconi. Les accords au sommet entre grands et petits partis, les plans de « recomposition de la gauche » sont voués à l’échec sans cette revitalisation du mouvement par en bas.
Articles portant sur des thèmes similaires :
- Misère du réformisme - 18/09/16
- Le monde rêvé des anges - 24/10/15
- Marx et la philosophie anglaise du XVIIe siècle - 23/02/14
- La passion du Même - 12/02/12
- Une recension de "La longueur de la chaîne" - 11/06/11
- Lasch avec Marx - 04/09/12
- Libertés en péril - 05/06/12
- Quelle laïcité pour quelle république? - 23/05/10
- La revendication d'homoparentalité et le malaise dans la culture - 21/11/09
- Gouvernance: une démocratie sans le peuple? - 29/05/08
Ecrit par dcollin
le Lundi 25 Avril 2011, 10:31
dans "Actualités"
Lu 6344 fois.
![]()
Article précédent -
Article suivant
Commentaires
Briser la chaîne reste nécessaire
Léopold - le 03-06-11 à 00:27 - #
Bien d'accord avec vous : supprimer les chaînes du salariat (/servage/esclavage - le dernier et le premier historiquement n'étant pas à tous égards le pire selon Marx). Et d'accord également pour aller vers les producteurs associés. Mais il étonnant que vous soyez néanmoins réformiste, vous qui êtes si lucide sur la puissance automate du capital. D'autant qu'il en train de passer à la vitesse supérieure. Le capitalisme financier n'est que de surface. L'analyse fondamentale de Marx n'a jamais été démentie : c'est du travail et du travail seul que le capital se nourrit. Il lui faut donc d'urgence remettre le lumpen au travail dans les conditions les plus dégradées depuis un siècle et demi. Ce qui ne se fera pas en douceur mais dans la plus grande violence si nécessaire. La social-démocratie ne fonctionne plus, la droite libérale (à peine différente) plus guère non plus. Reste donc le troisème fer que le capital tient au feu et vous savez lequel. Une révolution demeure donc nécessaire. Et le plus vite possible éant donnée la rapidité de la montée de l'extrême droite. Sous quelle forme? Nulle ne peut le dire a priori. L'Histoire crée les formes dans les événements qui les suggèrent. C'est aux hommes, "respons-ables", de les faire advenir en travaillant la matière de ces événements dans un libre jeu de leurs forces corporelles et intellectuelles. Premier sens d'un retour du politique à la pro-duction.
Politproductions.com